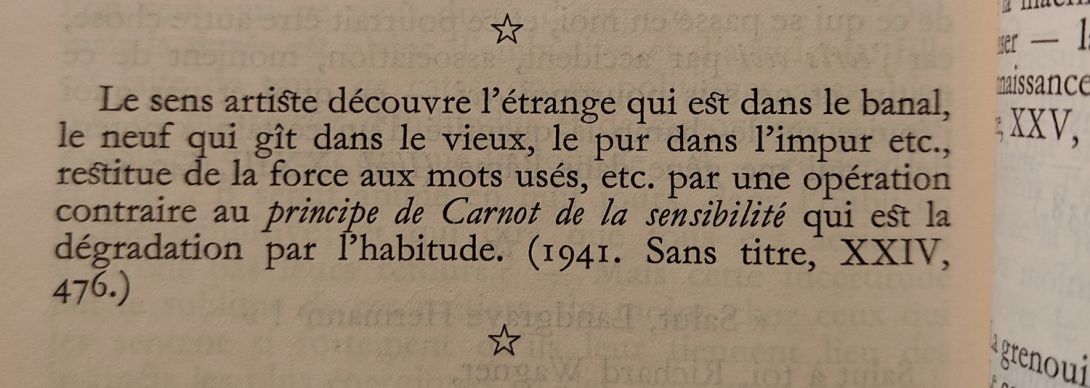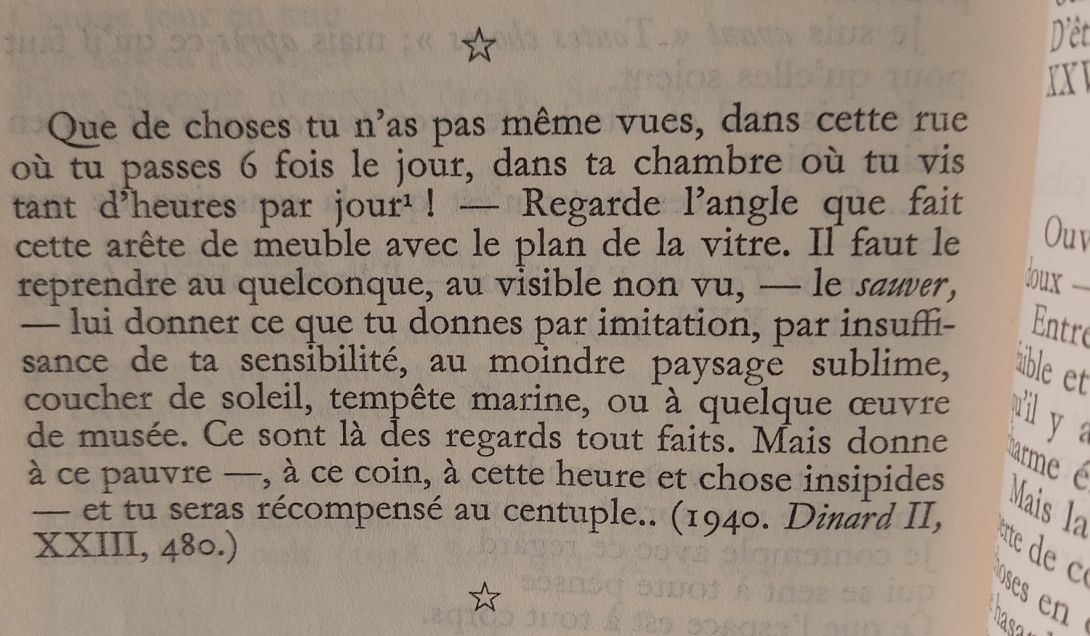Paul Valéry : Le sens artiste
*
Friedrich Nietzsche,
Marcel Proust,
Paul Valéry,
Laura Morante,
Edmond Jaloux :
Ce qu'il faut apprendre des artistes.
La leçon de Chardin et d'Elstir. Vinteuil.
***
Ce qu’il faut apprendre des artistes. — Quels moyens avons-nous de rendre pour nous les choses belles, attrayantes et désirables lorsqu’elles ne le sont pas ? — et je crois que, par elles-mêmes, elles ne le sont jamais ! Ici les médecins peuvent nous apprendre quelque chose quand par exemple ils atténuent l’amertume ou mettent du vin et du sucre dans leurs mélanges ; mais plus encore les artistes qui s’appliquent en somme continuellement à faire de pareilles inventions et de pareils tours de force. S’éloigner des choses jusqu’à ce que nous ne les voyions plus qu’en partie et qu’il nous faille y ajouter beaucoup par nous-mêmes pour être à même de les voir encore — ou bien contempler les choses d’un angle, pour n’en plus voir qu’une coupe — ou bien encore les regarder à travers du verre colorié ou sous la lumière du couchant — ou bien enfin leur donner une surface et une peau qui n’a pas une transparence complète : tout cela il nous faut l’apprendre des artistes et, pour le reste, être plus sages qu’eux. Car chez eux cette force subtile qui leur est propre cesse généralement où cesse l’art et où commence la vie ; nous cependant, nous voulons être les poètes de notre vie, et cela avant tout dans les plus petites choses quotidiennes.
Nietzsche, Le Gai savoir, Livre quatrième, 299
***
est-ce de notre faute si nous sommes nés pour l’air pur, nous autres rivaux des rayons de lumière, si nous aimerions mieux, pareils à ces rayons, chevaucher des parcelles d’éther, non pour quitter le soleil, mais pour aller vers lui ! Nous ne le pouvons pas : — faisons donc ce qui est seul en notre pouvoir : apportons la lumière à la terre, soyons « la lumière de la terre » !
Nietzsche, Le Gai savoir, Livre quatrième, 293
***
Je veux apprendre toujours davantage à considérer comme la beauté ce qu’il y a de nécessaire dans les choses : c’est ainsi que je serai de ceux qui rendent belles les choses. Amor fati : que cela soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas entrer en guerre contre la laideur. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Détourner mon regard, que ce soit là ma seule négation ! Et, somme toute, pour voir grand : je veux, quelle que soit la circonstance, n’être une fois qu’affirmateur !
Nietzsche, Le Gai savoir, Livre quatrième, 276
***
La leçon de Chardin
Prenez un jeune homme de fortune modeste, de goûts artistes, assis dans la salle à manger au moment banal et triste où on vient de finir de déjeuner et où la table n'est pas encore complètement desservie. L'imagination pleine de la gloire des musées, des cathédrales, de la mer, des montagnes, c'est avec malaise et avec ennui, avec une sensation proche de l’écoeurement, un sentiment voisin du spleen, qu'il voit un dernier couteau traîner sur la nappe à demi relevée qui pend jusqu'à terre, à coté d'un reste de côtelette saignante et fade. Sur le buffet un peu de soleil, en touchant gaiement le verre d'eau que des lèvres désaltérées ont laissé presque plein, accentue cruellement, comme un rire ironique, la banalité traditionnelle de ce spectacle inesthétique. Au fond de la pièce, le jeune homme voit sa mère, déjà assise au travail, qui dévide lentement, avec sa tranquillité quotidienne, un écheveau de laine rouge. Et derrière elle, perché sur une armoire, à côté d'un biscuit qu'on tient en réserve pour une "grande occasion", un chat gros et court semble le génie mauvais et sans grandeur de cette médiocrité domestique.
Le jeune homme détourne les yeux et voilà qu'ils tombent sur l'argenterie luisante et nette, plus bas sur les chenets flambants. Plus irrité de l'ordre de la chambre que du désordre de la table, il envie les financiers de goût qui ne se meuvent qu'au milieu de belles choses, dans des chambres où tout, jusqu'à la pincette de la cheminée et au bouton de la porte, tout est une oeuvre d'art. Il maudit cette laideur ambiante, et honteux d'être resté un quart d'heure à en éprouver, non pas la honte, mais le dégoût et comme la fascination, il se lève et, s'il ne peut pas prendre le train pour la Hollande ou pour l'Italie, va chercher au Louvre des visions de palais à la Véronèse, de princes à la Van Dyck, de ports à la Claude Lorrain, que, ce soir, viendra de nouveau ternir et exaspérer le retour dans leur cadre familier des scènes journalières.
Si je connaissais ce jeune homme, je ne le détournerais pas d'aller au Louvre et je l'y accompagnerais plutôt ; mais le menant dans la galerie Lacaze et dans la galerie des peintres français du XVIIIe siècle, ou dans telle autre galerie française, je l'arrêterais devant les Chardin. Et quand il serait ébloui de cette peinture opulente de ce qu'il appelait la médiocrité, de cette peinture savoureuse d'une vie qu'il trouvait insipide, de ce grand art d'une nature qu'il croyait mesquine, je lui dirais : Vous êtes heureux ? Pourtant qu'avez-vous vu là qu'une bourgeoise aisée montrant à sa fille les fautes qu'elle a faites dans sa tapisserie (La Mère laborieuse), une femme qui porte des pains (La Pourvoyeuse), un intérieur de cuisine où un chat vivant marche sur des huîtres, tandis qu'une raie morte pend aux murs, un buffet déjà à demi dégarni avec des couteaux qui traînent sur la nappe (Fruits et Animaux), moins encore, des objets de table ou de cuisine, non pas seulement ceux qui sont jolis, comme des chocolatières en porcelaine de Saxe (Ustensiles variés), mais ceux qui vous semblent le plus laids, un couvercle reluisant, les pots de toute forme et toute matière (la salière, l'écumoire), les spectacles qui vous répugnent, poissons morts qui traînent sur la table (dans le tableau de La Raie), et les spectacles qui vous écoeurent, des verres à demi vidés et trop de verres pleins (Fruits et Animaux).
Si tout cela vous semble maintenant beau à voir, c'est que Chardin l'a trouvé beau à peindre. Et il l'a trouvé beau à peindre parce qu'il le trouvait beau à voir. Le plaisir que vous donne sa peinture d'une chambre où l'on coud, d'une office, d'une cuisine. d'un buffet, c'est, saisi au passage. dégagé de l'instant, approfondi. éternisé. le plaisir que lui donnait la vue d'un buffet, d'une cuisine. d'une office, d'une chambre où l'on coud. Ils sont si inséparables l'un de l'autre que, s'il n'a pas pu s'en tenir au premier et qu'il a voulu se donner et donner aux autres le second, vous ne pourrez pas vous en tenir au second et vous reviendrez forcément au premier. Vous l’éprouviez déjà inconsciemment, ce plaisir que donne le spectacle de la vie humble et de la nature morte, sans cela il ne se serait pas levé dans votre coeur, quand Chardin avec son langage impératif et brillant est venu l'appeler. Votre conscience était trop inerte pour descendre jusqu'à lui. Il a dû attendre que Chardin vint le prendre en vous pour l'élever jusqu'à elle. Alors vous l'avez reconnu et pour la première fois vous l'avez goûté. Si en regardant un Chardin, vous pouvez vous dire : cela est intime, est confortable, est vivant comme une cuisine, en vous promenant dans une cuisine. vous vous direz : cela est beau comme un Chardin. Chardin n'aura été qu'un homme qui se plaisait dans sa salle à manger, entre les fruits et les verres, mais un homme d'une conscience plus vive, dont le plaisir trop intense aura débordé en touches onctueuses, en couleurs éternelles. Vous serez un Chardin, moins grand sans doute, grand dans la mesure où vous l'aimerez, où vous redeviendrez lui-même, mais pour qui, comme pour lui, les métaux et le grès s'animeront et les fruits parleront.
Voyant qu'il vous confie les secrets qu'il tient d'eux, ils ne se cacheront plus de vous les confier à vous-même. La nature morte deviendra surtout la nature vivante. Comme la vie, elle aura toujours quelque chose de nouveau à vous dire, quelque prestige à faire luire, quelque mystère à révéler ; la vie de tous les jours vous charmera, si pendant quelques jours vous avez écouté sa peinture comme un enseignement ; et pour avoir compris la vie de sa peinture vous aurez conquis la beauté de la vie.
Dans ces chambres où vous ne voyez rien que l’image de la banalité des autres et le reflet de votre ennui, Chardin entre comme la lumière, donnant à chaque chose sa couleur, évoquant de la nuit éternelle où ils étaient ensevelis tous les êtres de la nature morte ou animée, avec la signification de sa forme si brillante pour le regard, si obscure pour l’esprit. Comme la Princesse réveillée, chacun est rendu à la vie, reprend des couleurs, se met à causer avec vous, à vivre, à durer. Sur ce buffet où, depuis les plis raides de la nappe à demi relevée jusqu’au couteau posé de côté, dépassant de toute la lame, tout garde le souvenir de la hâte des domestiques, tout porte le témoignage de la gourmandise des invités. Le compotier aussi glorieux encore et dépouillé déjà qu’un verger d’automne se couronne au sommet de pêches joufflues et roses comme des chérubins, inaccessibles et souriantes comme des immortels. Un chien qui lève la tête ne peut arriver jusqu’à elles et les rend plus désirables d’être vainement désirées. Son oeil les goûte et surprend sur le duvet de leur peau qu’elle humecte, la suavité de leur saveur. Transparents comme le jour et désirables comme des sources, des verres où quelques gorgées de vin doux se prélassent comme au fond d’un gosier, sont à côté de verres déjà presque vides, comme à côté des emblèmes de la soif ardente, les emblèmes de la soif apaisée. Incliné comme une corolle flétrie un verre est à demi renversé ; le bonheur de son attitude découvre le fuseau de son pied, la finesse de ses attaches, la transparence de son vitrage, la noblesse de son évasement. À demi fêlé, indépendant désormais des besoins des hommes qu’il ne servira plus, il trouve dans sa grâce inutile la noblesse d’une buire de Venise.
Légères comme des coupes nacrées et fraîches comme l’eau de la mer qu’elles nous tendent, des huîtres traînent sur la nappe, comme, sur l’autel de la gourmandise, ses symboles fragiles et charmants.
Dans un seau de l’eau fraîche traîne à terre, toute poussée encore par le pied rapide qui l’a vivement dérangée. Un couteau qu’on y a vivement caché et qui marque la précipitation de la jouissance, soulève les disques d’or des citrons qui semblent posés là par le geste de la gourmandise, complétant l’appareil de la volupté. Maintenant venez jusqu’à la cuisine dont l’entrée est sévèrement gardée par la tribu des vases de toute grandeur, serviteurs capables et fidèles, race laborieuse et belle. Sur la table les couteaux actifs, qui vont droit au but, reposent dans une oisiveté menaçante et inoffensive. Mais au-dessus de vous un monstre étrange, frais encore comme la mer où il ondoya, une raie est suspendue, dont la vue mêle au désir de la gourmandise le charme curieux du calme ou des tempêtes de la mer dont elle fut le formidable témoin, faisant passer comme un souvenir du Jardin des Plantes à travers un goût de restaurant. Elle est ouverte et vous pouvez admirer la beauté de son architecture délicate et vaste, teintée de sang rouge, de nerfs bleus et de muscles blancs, comme la nef d’une cathédrale polychrome. À côté, dans l’abandon de leur mort, des poissons sont tordus en une courbe raide et désespérée, à plat ventre, les yeux sortis. Puis un chat, superposant à cet aquarium la vie obscure de ses formes plus savantes et plus conscientes, l’éclat de ses yeux posés sur la raie, fait manoeuvrer avec une hâte lente le velours de ses pattes sur les huîtres soulevées et décèle à la fois la prudence de son caractère, la convoitise de son palais et la témérité de son entreprise. L’oeil qui aime à jouer avec les autres sens et à reconstituer à l’aide de quelques couleurs, plus que tout un passé, tout un avenir, sent déjà la fraîcheur des huîtres qui vont mouiller les pattes du chat et on entend déjà, au moment où l’entassement précaire de ces nacres fragiles fléchira sous le poids du chat, le petit cri de leur fêlure et le tonnerre de leur chute.
Marcel Proust, Rembrandt et Chardin, 1895
***
La leçon d'Elstir
173. Je restais maintenant volontiers à table pendant qu'on desservait, et si ce n'était pas un moment où les jeunes filles de la petite bande pouvaient passer, ce n'était plus uniquement du côté de la mer que je regardais. Depuis que j'en avais vu dans des aquarelles d'Elstir, je cherchais à retrouver dans la réalité, j'aimais comme quelque chose de poétique, le geste interrompu des couteaux encore de travers, la rondeur bombée d'une serviette défaite où le soleil intercale un morceau de velours jaune, le verre à demi vidé qui montre mieux ainsi le noble évasement de ses formes et au fond de son vitrage translucide et pareil à une condensation du jour, un reste de vin sombre mais scintillant de lumières, le déplacement des volumes, la transmutation des liquides par l'éclairage, l'altération des prunes qui passent du vert au bleu et du bleu à l'or dans le compotier déjà à demi dépouillé, la promenade des chaises vieillottes qui deux fois par jour viennent s'installer autour de la nappe, dressée sur la table ainsi que sur un autel où sont célébrées les fêtes de la gourmandise et sur laquelle au fond des huîtres quelques gouttes d'eau lustrale restent comme dans de petits bénitiers de pierre ; j'essayais de trouver la beauté là où je ne m'étais jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des « natures mortes ».
(Avant de recevoir la leçon d'Elstir, le narrateur disait : 148. Et la marquise prit l'habitude de venir tous les jours en attendant qu'on la servît, s'asseoir un moment près de nous dans la salle à manger, sans permettre que nous nous levions, que nous nous dérangions en rien. Tout au plus nous attardions-nous souvent à causer avec elle, notre déjeuner fini, à ce moment sordide où les couteaux traînent sur la nappe à côté des serviettes défaites. Pour ma part, afin de garder, pour pouvoir aimer Balbec, l'idée que j'étais sur la pointe extrême de la terre, je m'efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer, d'y chercher des effets décrits par Baudelaire et de ne laisser tomber mes regards sur notre table que les jours où y était servi quelque vaste poisson, monstre marin qui au contraire des couteaux et des fourchettes était contemporain des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l'Océan, au temps des Cimmériens, et duquel le corps aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses, avait été construit par la nature, mais selon un plan architectural, comme une polychrome cathédrale de la mer.)
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu
*
Avec les leçons de Chardin et d'Esltir, Proust se distingue de Schopenhauer, qui écrivait :
"je trouve qu'il y a dans le domaine de l'art deux sortes de joli, toutes deux également indignes de l'art. L'une, tout à fait inférieure, se trouve dans les tableaux d'intérieur des peintres hollandais, quand ils ont l'extravagance de nous représenter des comestibles, de véritables trompe-l'œil qui ne peuvent que nous exciter l'appétit ; la volonté se trouve par là même stimulée, et c'en est fait de la contemplation esthétique de l'objet. Que l'on peigne des fruits, c'est encore supportable, pourvu que le fruit ne paraisse là que comme la suite du développement de la fleur, comme un produit de la nature, beau par sa couleur, beau par sa forme et que l'on ne soit point forcé de songer effectivement à ses propriétés comestibles ; mais malheureusement on pousse souvent la recherche de la ressemblance et de l'illusion jusqu'à représenter des mets servis et accommodés, tels qu'huîtres, harengs, homards, tartines de beurre, bière, vins, et ainsi de suite : cela est absolument inadmissible."
Arthur Schopenhauer - Le monde comme volonté et comme représentation
***

***
le monde (qui n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu)
232. Les gens de goût nous disent aujourd'hui que Renoir est un grand peintre du XVIIIe siècle. Mais en disant cela ils oublient le Temps et qu'il en a fallu beaucoup, même en plein XIXe, pour que Renoir fût salué grand artiste. Pour réussir à être ainsi reconnus, le peintre original, l'artiste original procèdent à la façon des oculistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose, n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit : « Maintenant regardez. » Et voici que le monde (qui n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu) nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des Renoir, ces Renoir où nous nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoir, et l'eau, et le ciel : nous avons envie de nous promener dans la forêt pareille à celle qui le premier jour nous semblait tout excepté une forêt, et par exemple une tapisserie aux nuances nombreuses mais où manquaient justement les nuances propres aux forêts. Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être créé. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux.
*
357. Chaque grand artiste semble en effet si différent des autres, et nous donne tant cette sensation de l'individualité, que nous cherchons en vain dans l'existence quotidienne ! (...) La musique bien différente en cela de la société d'Albertine, m'aidait à descendre en moi-même, à y découvrir du nouveau : la variété que j'avais en vain cherchée dans la vie, dans le voyage, dont pourtant la nostalgie m'était donnée par ce flot sonore qui faisait mourir à côté de moi ses vagues ensoleillées.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu
***
Vinteuil
121. Mais, moins décevants que la vie, ces grands chefs-d'oeuvre ne commencent pas par nous donner ce qu'ils ont de meilleur. Dans la sonate de Vinteuil les beautés qu'on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite et pour la même raison sans doute, qui est qu'elles diffèrent moins de ce qu'on connaissait déjà. Mais quand celles-là se sont éloignées, il nous reste à aimer telle phrase que son ordre trop nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion nous avait rendue indiscernable et gardée intacte ; alors elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s'était réservée, qui par le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue, elle vient à nous la dernière. Mais nous la quitterons aussi en dernier. Et nous l'aimerons plus longtemps que les autres, parce que nous aurons mis plus longtemps à l'aimer. Ce temps du reste qu'il faut à un individu – comme il me le fallut à moi à l'égard de cette sonate – pour pénétrer une oeuvre un peu profonde, n'est que le raccourci et comme le symbole des années, des siècles parfois, qui s'écoulent avant que le public puisse aimer un chef-d'oeuvre vraiment nouveau. Aussi l'homme de génie pour s'épargner les méconnaissances de la foule se dit peut-être que, les contemporains manquant du recul nécessaire, les oeuvres écrites pour la postérité ne devraient être lues que par elle, comme certaines peintures qu'on juge mal de trop près. Mais en réalité toute lâche précaution pour éviter les faux jugements est inutile, ils ne sont pas évitables. Ce qui est cause qu'une oeuvre de génie est difficilement admirée tout de suite, c'est que celui qui l'a écrite est extraordinaire, que peu de gens lui ressemblent. C'est son oeuvre elle-même qui en fécondant les rares esprits capables de le comprendre, les fera croître et multiplier. Ce sont les quatuors de Beethoven (les quatuors XII, XIII, XIV et XV) qui ont mis cinquante ans à faire naître, à grossir le public des quatuors de Beethoven, réalisant ainsi comme tous les chefs-d'oeuvre un progrès sinon dans la valeur des artistes, du moins dans la société des esprits, largement composée aujourd'hui de ce qui était introuvable quand le chef-d'oeuvre parut, c'est-à-dire d'êtres capables de l'aimer. Ce qu'on appelle la postérité, c'est la postérité de l'oeuvre. Il faut que l'oeuvre (en ne tenant pas compte, pour simplifier, des génies qui à la même époque peuvent parallèlement préparer pour l'avenir un public meilleur dont d'autres génies que lui bénéficieront) crée elle-même sa postérité. Si donc l'oeuvre était tenue en réserve, n'était connue que de la postérité, celle-ci, pour cette oeuvre, ne serait pas la postérité mais une assemblée de contemporains ayant simplement vécu cinquante ans plus tard. Aussi faut-il que l'artiste – et c'est ce qu'avait fait Vinteuil – s'il veut que son oeuvre puisse suivre sa route, la lance, là où il y a assez de profondeur, en plein et lointain avenir.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu
***
Que de choses tu n'as pas même vues, dans cette rue où tu passes 6 fois le jour, dans ta chambre où tu vis tant d'heures par jour ! - Regarde l'angle que fait cette arête de meuble avec le plan de la vitre. Il faut le reprendre au quelconque, au visible non vu, - le sauver, - lui donner ce que tu donnes par imitation, par insuffisance de ta sensibilité, au moindre paysage sublime, coucher de soleil, tempête marine, ou à quelque oeuvre de musée. Ce sont là des regards tout faits. Mais donne à ce pauvre -, à ce coin, à cette heure et chose insipides - et tu seras récompensé au centuple.
Paul Valéry, 1940, Cahiers II, Poèmes et PPA, Pléiade, page 1304
- repris sous le titre Un regard charitable, dans Oeuvres I, Mélange, Instants, Pléiade, page 383
*
Le sens artiste découvre l'étrange qui est dans le banal, le neuf qui gît dans le vieux, le pur dans l'impur, restitue de la force aux mots usés, par une opération contraire au principe de Carnot de la sensibilité qui est la dégradation par l'habitude.
Paul Valéry, 1941, Cahiers II, Poïétique, Pléiade, page 1048
***
A mon avis, le plus gros danger dans un rôle pareil, c’est le naturalisme. On m’a demandé par exemple si je pensais à mes propres enfants pour jouer la douleur de cette mère qui perd son fils. Absolument pas ! En tout cas pas de manière consciente parce que je trouverais ça extrêmement cynique. La vie est un chaos, et la fonction de l’art est d’extraire quelques éléments du chaos pour les rendre plus perceptibles. Tout le monde s’émeut en voyant les pommes de Cézanne, mais des pommes sur une table n’émeuvent pas tout le monde. Et pourtant quelque part ce sont les mêmes pommes : c’est de là que ça vient. Mais Cézanne a extrait du chaos sa vision des pommes. Je me souviens avoir lu sa correspondance avec Stevenson : ils étaient très en colère contre le naturalisme à la Zola. Ils craignaient la fin de la littérature. Et à un moment, Stevenson dit : « Qui serait ce fou de peintre qui voudrait en peignant le soleil se mettre en compétition avec le vrai soleil ? » Il n’y a pas de compétition possible : le vrai soleil brûle. Donc c’est évident que tu vas chercher autre chose. Tout le monde peut inventer sauf l’artiste. L’artiste rédige ce qu’il a vraiment vu et écouté avec le maximum d’attention. Ce qui nous émeut dans une nature morte de Chardin, c’est que nous y voyons la vérité. Mais ce n’est pas naturaliste. Parce que qu’est-ce qui est plus naturaliste que la nature ? Quand Van Gogh peint des fleurs, c’est certainement pas naturaliste, mais il y a une vérité qu’on n’aurait peut-être pas saisie en regardant ces fleurs. Il n’y a pas d’oeuvre qui soit vraie dans l’absolu. Pour moi, c’est la générosité de l’art. Un artiste ne monologue pas, il dialogue. C’est un échange, et c’est ça qui est beau. Pour qu’il y ait art, il faut un artiste qui crée, et un spectateur qui soit lui aussi un artiste pour être capable de saisir.
***
***
A contrario, Swann : "Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu’il avait d’abord trouvées jolies".
045. Il n'était pas comme tant de gens qui par paresse ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester attaché à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisirs, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les divertissements médiocres ou les supportables ennuis qu'elle renferme. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'était souvent des femmes de beauté assez vulgaire, car les qualités physiques qu'il recherchait sans s'en rendre compte étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression, glaçaient ses sens que suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu
Et pourtant :
cette page inouïe où l'on voit Swann s'éprendre d'Odette à cause de sa ressemblance avec une figure de Botticelli que, d'ailleurs, il n'aime pas, mais qu'il se met à chérir à cause d'elle, si bien que ces deux reflets agissant l'un sur l'autre finissent par proliférer mutuellement jusqu'à ce qu'un amour naisse de leur action simultanée.
Edmond Jaloux, Sur la psychologie de Marcel Proust, Hommage à Marcel Proust, NRF, 1923
053. Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d'Odette, une reproduction de la fille de Jéthro. Il admirait les grands yeux, le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite, les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées, et adaptant ce qu'il trouvait beau jusque-là d'une façon esthétique à l'idée d'une femme vivante, il le transformait en mérites physiques qu'il se félicitait de trouver réunis dans un être qu'il pourrait posséder. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'oeuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jéthro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette ne lui avait pas d'abord inspiré. Quand il avait regardé longtemps ce Botticelli, il pensait à son Botticelli à lui qu'il trouvait plus beau encore et, approchant de lui la photographie de Zéphora, il croyait serrer Odette contre son coeur.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu
*
*